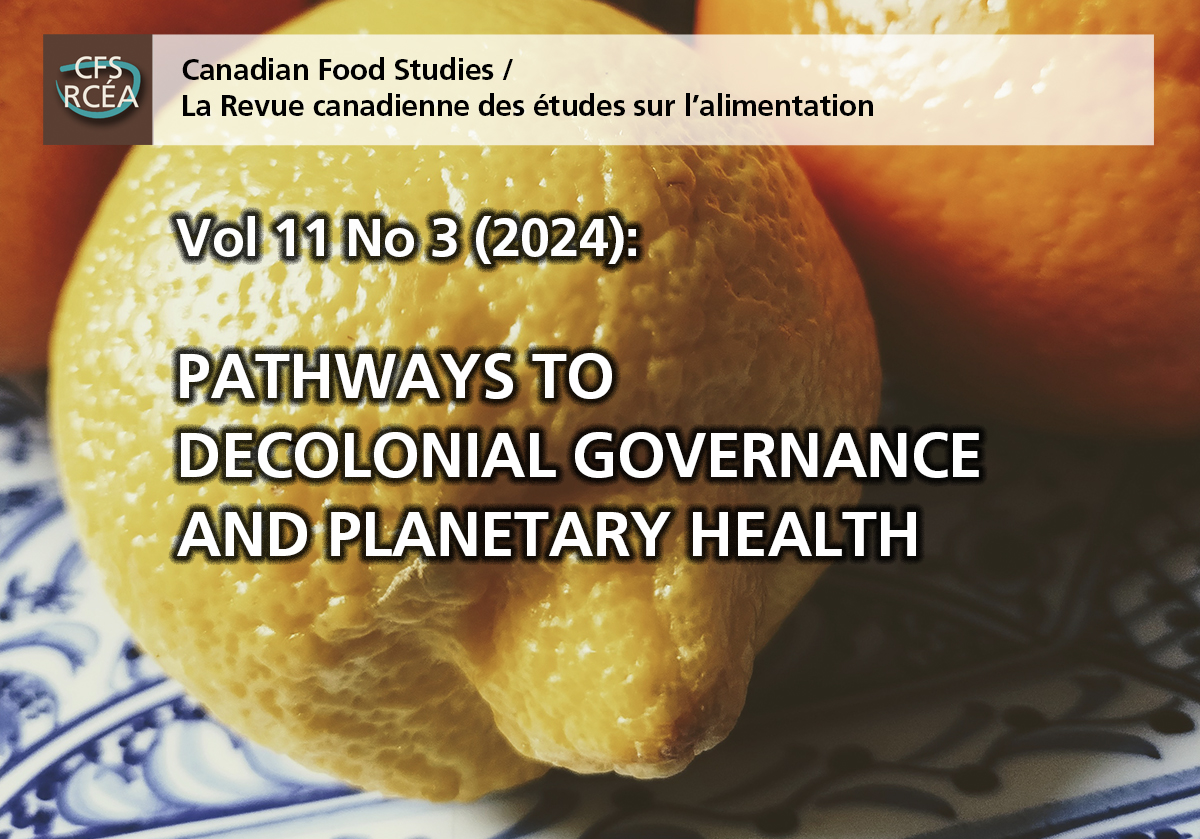Digesting Food Studies (the CFS podcast) hits 10 episodes!
The CFS podcast, "Digesting Food Studies" is halfway through its first season, with 10 episodes now available on most major podcasting platforms. Go to foodstudies.info/podcast or rss.com/podcasts/digesting-food-studies for more information or click on the links below to listen!
1.00 – Welcome to Food Studies
1.01 – Introducing Meat Studies
1.02 – Teaching about Food Systems
1.03 – Food Art & Material Practice
1.04 – Infant Food Insecurity
1.05 – Indigenous Food Sovereignty
1.06 – School Food Programs
1.07 – Les pesticides et la politique
1.08 – Un-learning and Re-learning
1.09 – Food Waste
1.10 – Feminist Food Studies